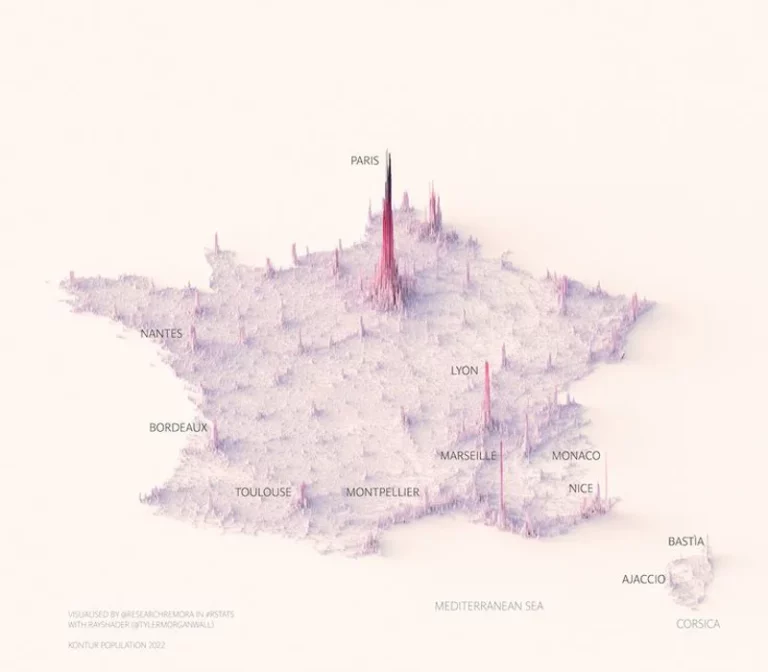La visée « Processus » évoque deux manières d’engager un processus de transformation de la société : le « Grand soir » ou une progression permettant de faire reculer le système à partir de revendications. On sait que, de ce côté il y a un sacré refus du système en place, qui ne cède pas la moindre miette, à la différence de ce qui avait été permis après la seconde guerre mondiale. On assiste même à une remise en cause de ce qui avait, alors, été « lâché ».
En fait, les mécanismes institutionnels mis en place pour la sauvegarde de la société capitaliste semblent bloqués. « Bloqués » dans ce sens où leurs tenants sont incapables d’envisager le moindre bougé. Mais « bloqués » aussi dans ce sens où les écrous sont bien serrés pour donner le sentiment qu’on est en présence d’un idéal. La démocratie parlementaire (entendons « le système électoral ») serait cet idéal. Churchill fait l’unanimité : « c’est un mauvais système… mais c’est le moins mauvais ». Chaque période électorale est ainsi montée en épingle par l’État et toutes les structures institutionalisées, y compris les structures politiques mises en place pour concourir dans cette compétition sans fin. Sans fin et sans pause dans la mesure où l’accumulation et la répartition des différents types de scrutin imposent une actualité permanente. Les Jeux Olympiques, on en parle pendant un an tous les 4 ans. Le Grand barnum des élections doit occuper nos esprits chaque jour de chaque année, et affaiblir nos capacités de réflexion sur le long terme[1].
Les partis politiques (dont l’organisation est calquée sur celle des institutions de l’État) sont dans ce piège, qu’ils en soient conscients ou non. Comme si ce chemin-là était le seul dont disposerait la société des citoyens d’un pays (d’une région, d’une ville, etc).
On assiste cependant depuis quelques années au recours à d’autres formes d’intervention de la société des citoyens. Que l’on repense à ce qui s’est passé au Larzac, à Notre-Dame-des-Landes, et plus récemment autour des bassines, ou de l’A69…
Et c’est à un autre niveau que l’on pense aussi à cette fameuse pétition sur la loi Duplomb, lancée cet été 2025 par une jeune citoyenne, et qui a recueilli plus de 2 millions de signatures. C’est à un autre niveau parce que cette fois, cette initiative touche « le dur », à propos d’une loi qui vient d’être votée… et à l’aide d’un outil institutionnel (la plateforme parlementaire) et non pas par un traditionnel moyen de pétition dite « citoyenne » (qu’elle soit réellement citoyenne ou non).
Il est peut-être temps, il est peut-être possible alors, que les citoyens se mêlent de ce qui leur échappait en grande partie jusqu’alors.
De quoi réfléchir…
On a vu plus haut à quel point le système de démocratie parlementaire (ou autres élections) basé sur la « représentation » échappait, pour l’essentiel, aux citoyens de notre pays. Nous avons pu enregistrer, sur les élections municipales, quelques expériences intéressantes de « listes citoyennes », mais qui, pour beaucoup, n’auront pas fait long feu. La difficulté réside généralement dans le manque de moyens dont dispose la militance citoyenne pour tenir dans le temps. Et les récentes saignées imposées au monde associatif n’arrangent rien.
En attendant (mais surtout sans attendre une Grande Après-midi) il pourrait être judicieux de contourner la voie partidaire des législatives en recherchant les moyens de candidatures citoyennes hors des partis, y compris les moyens financiers puisque les élections législatives sont le principal canal de ce que l’on appelle le « financement public de la vie politique ». Si bien que même les plus petits partis (qui n’ont aucune chance d’obtenir un élu) présentent des candidats au premier tour de scrutin car c’est là qu’est attribuée la première partie de ce financement. Un mouvement citoyen suffisamment conséquent dans une circonscription pourrait ainsi utiliser le premier tour d’une législative pour faire connaître son action… et recueillir les moyens financiers de son action pour les cinq années suivantes (en 2024 : 1,61€ par électeur pendant 5 ans). Bien sûr, cela nécessiterait de trouver un accord avec l’un des partis autorisés à concourir, non pas un « arrangement » plus ou moins contestable, mais un contrat équitable tout ce qu’il y a de plus légal et qui pourrait profiter à chacun. On a connu de telles situations. Il suffit que l’accord mentionné plus haut prévoit clairement que l’association de financement reverse tel ou tel pourcentage des fonds perçus de l’État à l’association. Avec le développement des assemblées citoyennes du Front Populaire, on pourrait imaginer de creuser cette piste..
Bien sûr, il y aurait le « risque » qu’un tel candidat gagne le siège de député. Mais ce « député citoyen ». pourrait alors se comporter non pas en « représentant », mais en « porte-parole ». Voilà qui changerait beaucoup.
Bon… on n’en est pas encore à l’entrée de la cuisinière de Lénine à la tête de l’État. D’ailleurs, l’État…
André Pacco
13 août 2O25
[1] La question de la représentation et du système électoral est traitée dans la « visée Démo-cratie ». Mais, bien sûr des réflexions, des propositions de cet article-ci peuvent rejoindre réflexions et propositions de cette autre « visée ».