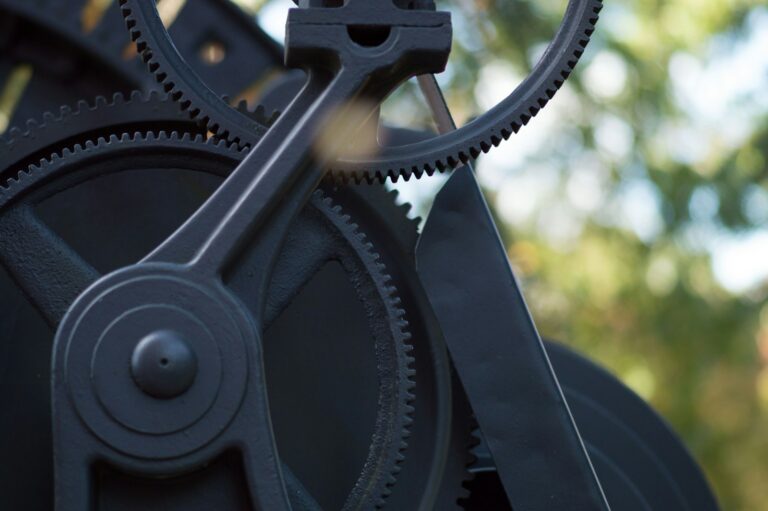« Pouvoir du peuple » appelle à déconstruire ce qui est pour nous la normalité : lorsque, après avoir provoqué des changements, un mouvement populaire s’arrête et confie la suite à l’État, l’Histoire nous dit que, dans le meilleur des cas, il n’y a pas de suite et le plus souvent les transformations obtenues sont battues en brèche.
Actuellement, le seul moment où le rôle politique des citoyen·nes est reconnu est le moment électoral. On leur reconnaît le droit de protestation, de grève, mais au plan politique leur droit relève exclusivement du droit individuel d’avoir ses opinions et n’englobe aucun moment collectif.
L’héritage est lourd. Sieyès en 1789 : « le peuple n’a pas d’existence politique propre, il ne peut parler que par ses représentants, le peuple ne peut rien vouloir en commun ; donc il ne peut faire aucune loi, il ne peut rien en commun puisqu’il n’existe pas de cette manière… ». En 1791 : « Il est temps que la Révolution s’arrête, le moyen en est la représentation nationale ».
Aujourd’hui tout concourt à casser la prééminence de la loi commune au profit du contrat de gré à gré entre individus, dans des rapports d’allégeance. Le système représentatif ne correspond plus aux besoins de qui que ce soit. Pour les dominé·e·s, c’est une absorption de ce qui devrait être leur pouvoir sur leur devenir ; pour le capital, les décisions parlementaires sont encore trop sous la pression populaire. Nous sommes face à un mouvement rampant vers un nouveau type de totalitarisme comme nouvelle phase du capitalisme.
Cela met en question tous les organismes qui nous surplombent et, ce faisant nous attribuent notre identité collective : l’État mais aussi les partis politiques, les syndicats, souvent les associations qui, en prétendant incarner les idéaux de leurs adeptes, leur demande « adhésion » et délégation de pouvoir, se substituent à eux, et finissent par faire de l’appareil sa propre finalité.
Peut-on envisager que l’affirmation du rôle du peuple ne commence qu’après une victoire sur le capital et ses forces ? Par quel miracle la posture délégataire actuelle pourrait-elle ensuite déboucher sur son contraire, une fois le capitalisme vaincu ? Il ne s’agit pas de faire disparaître l’institué ni faire disparaître l’État du jour au lendemain mais de le faire progressivement dépérir au fur et à mesure qu’il y a appropriation par l’exercice de la citoyenneté. Et ce processus est une condition du refus de la soumission aux forces de l’argent. Mais ce dépérissement ne vient pas seulement comme conclusion, il doit influer sur la nature du processus. Si la méthode demeure étrangère à la nature du but, le but n’est jamais atteint. On l’a vu avec l’Histoire. La portée des comportements de dé-liaison précipite (au sens chimique) la prise de conscience. Avant même d’avoir obtenu ce que l’on vise, la confiance en soi que produit toute volonté de maitrise sur son devenir, change la place de la personne et décuple la force des mouvements. C’est un des grands apports du mouvement des femmes.